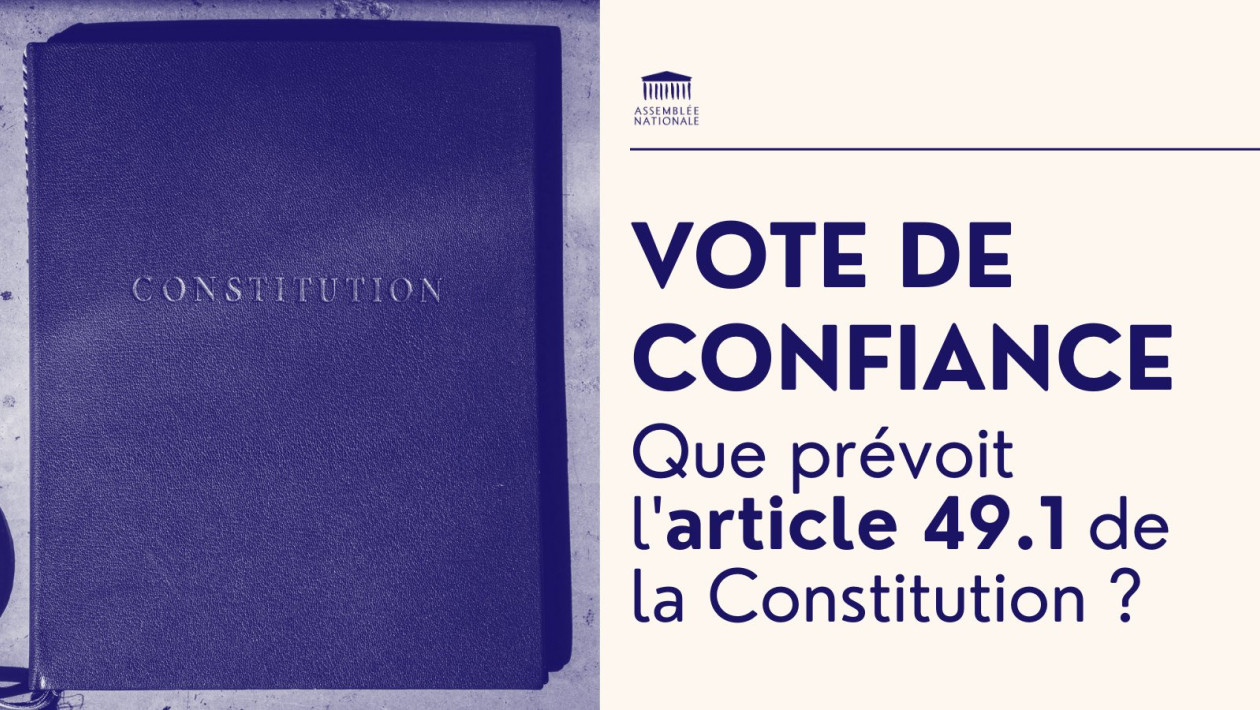
Le vote de confiance est prévu à l’article 49 alinéa 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 (celle de la Ve République française). Cet article est surnommé "49.1". Il dispose que "le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale". Il est important de préciser que l’utilisation de cet article n’est obligatoire pour aucun Premier ministre, dans aucun cas.
En France, le système du vote de confiance existait déjà sous la IVe République (1946-1958). À cette époque, le Premier ministre portait le titre de Président du Conseil. Lorsqu’il était choisi par le président de la République, il devait obligatoirement exposer son programme, c’est-à-dire présenter sa déclaration de politique générale devant les députés (l’Assemblée nationale). Ceux-ci devaient ensuite voter pour accorder, ou non, leur confiance au chef du gouvernement. Si cette confiance était accordée, alors le Président du Conseil et ses ministres étaient nommés par le président de la République. À l’inverse, le gouvernement n’était pas constitué.
La Constitution de la Ve République (élaborée par Charles de Gaulle et Michel Debré) reprend le principe du vote de confiance, mais le rend facultatif. L’objectif est d’éviter les fortes instabilités politiques de la IVe République. Ainsi, au moment où le Premier ministre présente sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, quelques semaines après sa nomination, il n’est pas obligé de demander la confiance des députés. Il peut également refaire une déclaration de politique générale à un autre moment, sans nécessairement solliciter un vote de confiance.
Pour que le chef du gouvernement puisse recourir au 49.1, une condition doit être respectée : cette décision doit être prise en conseil des ministres. Cela signifie que le Premier ministre ne peut pas l’engager seul, sans avoir au préalable consulté les ministres (même s’il n’est pas tenu de suivre leur avis).
Si un vote de confiance est décidé, plusieurs étapes s’enchaînent. Tout d’abord, le chef du gouvernement prononce une déclaration de politique générale devant les députés. Cela donne lieu à un débat à l’Assemblée nationale. Ensuite, après une pause de plusieurs minutes ou heures, les députés présents procèdent au vote. Pour que la confiance soit accordée, la majorité des députés ayant voté doit se prononcer en faveur du gouvernement (donc avoir voté "pour").
Par conséquent, il s’agit d’un vote à la majorité simple des suffrages exprimés : les abstentions ainsi que les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte. En effet, seuls les "pour" et les "contre" sont comptés.
Une fois le vote terminé, deux cas de figure sont possibles : soit la majorité des députés a voté la confiance, et le gouvernement reste en place ; soit cette majorité n’a pas voté la confiance, et le Premier ministre doit remettre la démission de son gouvernement au président de la République (qui ne peut pas la refuser). Ce dernier cas est prévu par l’article 50 de la Constitution de 1958.
Depuis le début de la Ve République et jusqu’à août 2025, il y a eu 41 votes de confiance. Ils ont tous été favorables aux gouvernements, car les 22 Premiers ministres qui y ont eu recours disposaient d’une majorité (relative ou absolue) à l’Assemblée nationale. Cela signifie que leur parti politique était largement représenté parmi les députés. Néanmoins, en 1986, le vote de confiance demandé par le Premier ministre Jacques Chirac n'a fonctionné qu'à 7 voix près.
Le record d’utilisation du 49.1 revient à Pierre Mauroy, qui y a eu recours cinq fois entre 1981 et 1984.
Le dernier (avant septembre 2025) avait eu lieu en juillet 2020, à l’initiative de Jean Castex.
Après plus de cinq ans sans aucun vote de confiance, le Premier ministre François Bayrou en a demandé un pour le 8 septembre 2025, presque neuf mois après sa prise de fonction (le 13 décembre 2024). Cette décision a été prise dans un contexte politique tendu, notamment à cause de la situation budgétaire préoccupante de la France.
Au final, sans surprise, la majorité des députés présents a voté contre la confiance. Sur les 573 députés présents (le nombre total étant de 577), seulement 194 ont voté "pour" et 15 se sont abstenus. Cela signifie que 364 députés ont refusé d’accorder leur confiance au gouvernement Bayrou, aussi bien les élus du Parti Socialiste (gauche) et des Écologistes (gauche) que ceux de La France Insoumise (extrême-gauche) et du Rassemblement National (extrême-droite). Bien évidemment, d'autres partis ont également voté "contre".
François Bayrou a donc déposé la démission de son gouvernement le 9 septembre 2025. Le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé un nouveau Premier ministre le même jour : Sébastien Lecornu.
En moins d’un an, la France a donc connu deux situations historiques à l’Assemblée nationale : le 4 décembre 2024, c’était la première fois (sous la Ve République) qu’un gouvernement (celui de Michel Barnier) tombait à la suite de l’adoption d’une motion de censure provoquée par l’article 49.3 ; le 8 septembre 2025, c’était la première fois qu’un gouvernement (celui de Bayrou) tombait après un vote de confiance défavorable.
Pour savoir si vous avez bien compris le fonctionnement du 49.1, je vous invite à faire le quiz de 8 questions ci-dessous. Il est présenté sous forme de petits cas pratiques et c'est un QCM.
Bon quiz !